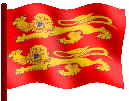-
Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 12:20

Château de Pontécoulant La façade
avant du château.
L'Histoire du Comte Doulcet de Pontecoulant...
Le bâtiment de droite est la partie la plus récente.
TypeMaison forteDébut construction 2e moitié du XVIe siècleDestination actuelle Musée Protection Inscrit MH (1927)
Le château de Pontécoulant est situé au cœur du bocage normand, à Pontécoulant près de Condé-sur-Noireau.
Le domaine de Pontécoulant rassemble les marques distinctives de la noblesse :
château, pavillons du garde-chasse et du jardinier,
colombier, parc paysager,
ferme, bois et terres.
La famille Le Doulcet de Pontécoulant s'y est établie au XIV siècle et s'y est éteinte en 1896, laissant le château au département du Calvados, qui l'aménagea en musée dès 1908.
Il fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques
depuis le 26 mars 1927

Histoire :
La famille Le Doulcet de Pontécoulant s'établit au château au XIVè siècle.
Grâce aux mariages entre nobles, la famille devient puissante, acquérant le privilège de posséder un colombier, 343 hectares de terre éparpillées dans la Manche et le Calvados.
Comme beaucoup de familles d'aristocrates, les Doulcet de Pontécoulant vivaient au-dessus de leurs moyens, c'est ainsi qu'au XVI siècle,
Léon-Armand Doulcet de Pontécoulant se voit obligé de vendre les 2/3 de ses terres ainsi qu'une partie du mobilier, ce qui va permettre de restaurer la propriété et de construire la deuxième partie du château.

Architecture :
Construit au XVI siècle, à l’emplacement d’une ancienne maison forte, le château est agrandi et réaménagé dans la seconde moitié du XVIII siècle, pour devenir la résidence d’été de la famille de Pontécoulant qui vit alors à Caen et à Paris.

Deux pavillons d’entrée, l’un dit « du jardinier » et l’autre « du garde-chasse » furent alors édifiés pour marquer le seuil de la cour d’honneur.
Fermant la perspective, la demeure masquait les jardins où le marquis fit aménager terrasses, murs, allées et bosquets.
Ses descendants ne modifièrent plus la propriété qu’il avait dessinée.

Le château de Pontécoulant à l'été 2009 Parc et jardins
Le parc et les jardins du château forment un site classé inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.
Ce site se compose d'un jardin avec sa pièce d'eau et sa cascade, d'un jardin potager et du parc où sont construits une glacière et un monument !

Anecdote :
lorsque j'ai découvert cette merveille au milieu de la verdure...et visiter ce château.... la guide nous a expliqué, que sous l'occupation, ce château avait été réquisitionné par l'occupant.... ses propriètaires avaient caché dans les combles, des mètrages de tissu en toile de Jouy.... de l'époque du XVIIIè siècle.... sauvegardé, ce tissu a servi par la suite à tapisser certaines pièces....une merveille à aller visiter.....son bassin aux iris d'eau... sous le sous bois.....
 Château de PontécoulantSitué au coeur du bocage normand, près de Condé-sur-Noireau,dans la vallée de la Druance, le domaine de Pontécoulant est formé de différents bâtiments.La famille Le Doulcet de Pontécoulant s'y est établie au XIVème siècle.
Château de PontécoulantSitué au coeur du bocage normand, près de Condé-sur-Noireau,dans la vallée de la Druance, le domaine de Pontécoulant est formé de différents bâtiments.La famille Le Doulcet de Pontécoulant s'y est établie au XIVème siècle.
Le château fut construit au XVIème siècleà l'emplacement d'une ancienne maison forte.A l'intérieur, vous trouverez le mobilier illustrant le mode de vie de ses occupants pendant le XIXème siècle.
A l'extérieur, les pavillons du garde-chasse et du jardinier, le colombier, la ferme et le parc sont représentatifs de la noblesse.Toile de Jouy, sauvegardée par les propriétaires sous l'occupation...toile authentique du XVIIIè siècle...Doulcet (Louis-Gustave), comte de Pontécoulant(D’après « Études historiques et biographiques - Tome II » paru en 1857)Louis-Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant,naquit à Caen le 9 novembre 1764.Sa famille est ancienne et considérable en Normandie.Dans une liste authentique, écrite par ordre de Louis XI,Guillaume le Doulcet de Pontécoulant est portécomme gentilhomme d’ancienne noblesse.Au seizième siècle, Robert de Pontécoulant était capitaine de cinquante hommes d’armes, gentilhomme de la chambre du roi et chevalier de ses ordres.Thomas de Pontécoulant fut fait, pour ses services signalés,maréchal de camp en 1653.Le marquis de Pontécoulant se distingua par des actions d’éclat dans la guerre de Sept Ans ; il fut maréchal de camp et major général des gardes du corps.
Son fils Louis-Gustave entra dès l’âge de quinze ans dans les gardes du corps ; puis devint capitaine de carabiniers et passa ensuite comme officier dans les gardes du corps.
On était alors en pleine paix, et l’état militaire laissait beaucoup de loisir aux officiers, surtout lorsqu’ils appartenaient à la maison du roi ;
Gustave de Pontécoulant en profita pour voyager.
Ayant pour compagnon le marquis, depuis duc de Lévis, qui fut son ami pendant toute sa vie, il assista, en 1784, aux grandes manœuvres de Frédéric II ;
ils furent présentés à cet illustre souverain qui les accueillit avec une gracieuse bienveillance.
Continuant leurs voyages, ils saluèrent aussi l’empereur Joseph et l’impératrice Catherine.

La révolution de 1789 trouva Pontécoulant disposé aux opinions libérales ;
il était persuadé que de grandes réformes étaient nécessaires, et que des garanties devaient être données, afin de prévenir les abus et les désordres d’administration, puisque le pouvoir royal, tout absolu qu’il était, et peut-être parce qu’il était absolu, ne pouvait ni les empêcher, ni les réprimer ;
il n’aurait voulu rien de plus. Lorsque furent établies les administrations départementales, il fut élu administrateur du Calvados.
En 1792, il fut député à la Convention.
Dans les premiers jours de cette Assemblée, il demanda le renouvellement de toutes les administrations et s’opposa à ce que l’Assemblée maintînt, par voie d’invitation, Roland et Servan dans les ministères de l’intérieur et de la guerre ;
bientôt après il fut au nombre des commissaires que la Convention envoya à l’armée du Nord.

Les Girondins A ce moment Lille soutenait un siège, qui honora le courage de la garnison et la constance des habitants.Les commissaires s’occupèrent surtout à diriger des convois de vivres et de munitions dans la ville, qui n’était pas entièrement investie, et à favoriser de tout leur pouvoir les mouvements de l’armée que commandait le général Labourdonnaie, de manière à déterminer la levée du siège.Peu de jours après leur arrivée Lille fut en effet délivré. Pontécoulant passa encore quelque temps à l’armée.Lorsqu’il revint prendre sa place dans la Convention le procès du roi était commencé, et déjà la lutte entre les Girondins et la Montagne agitait les séances.Depuis que la guerre était déclarée et le trône renversé, il n’avait pas une autre préoccupation que la défense du territoire contre les armées de la coalition et contre l’intervention des puissances étrangères dansle gouvernement intérieur de la France.Pendant quelque temps il se flatta peut-être qu’un pouvoir énergique parviendrait à rétablir, puis à maintenir l’ordre public, et qu’il triompherait des ennemis extérieurs et intérieurs.Dans cette pensée, il se montra parfois opposé aux Girondins qui, animés par un esprit de parti et des intérêts d’ambition, affaiblissaient l’autorité de la Convention.Mais il restait invariable dans son amour et son respect pour la justice et l’humanité ; il publia un écrit où il maudissait les massacres de septembre et leurs odieux instigateurs.Lorsqu’il arriva de l’armée, la Convention avait déjà résolu que le roi serait mis en accusation et jugé par elle.
Dans le premier appel nominal sur la question de culpabilité, il développa son opinion sur les trois questions qui devaient être successivement posées et discutées.
« Je pense, dit-il, que nommés juges par la Convention, et législateurs par le peuple, nous devons prendre les mesures les plus utiles pour assurer l’abolition de la royauté et l’établissement de la république ».
En ce sens, il vota pour le bannissement à perpétuité de Louis et de sa famille.

A ces mots des murmures s’élevèrent ;
ceux qui avaient résolu la mort du roi s’efforçaient d’obtenir la majorité, en intimidant leurs collègues qui se refusaient à cette funeste iniquité.
« Les murmures que j’entends, dit-il, m’affligent pour ceux qui s’en rendent coupables, mais ne m’arrêtent pas. Je vais répéter mon vote ».
Il y ajoute que le décret rendu par la Convention devrait être soumis à la ratification du peuple souverain, qui prononcerait aussi sur l’abolition de la royauté.
Il écrivit et signa sou opinion pour qu’elle fût insérée au procès-verbal.
Au second appel nominal, sur l’appel au peuple, il ne vota point.
Déjà il avait exprimé son opinion sur cette question ;
comme il lui semblait que ce scrutin était une manœuvre pratiquée par les Girondins dans une toute autre intention que de sauver le Roi, il ne voulut pas y prendre part. Dans le scrutin sur la peine, il répéta que le Roi devait être banni ; enfin il vota pour le sursis.

Pendant les premiers moments qui suivirent cette révolution, le parti qui avait remporté une victoire, facile à Paris et dans la Convention, n’était point assuré contre les insurrections, qui éclataient dans presque toute la France en faveur du parti vaincu et contre la violation de la représentation nationale.
Ainsi il usa d’abord du pouvoir absolu qu’il avait conquis avec une sorte de timidité et d’hésitation.
Parmi les députés décrétés d’arrestation, par une minorité peu nombreuse restée dans la salle, les uns s’étaient éloignés de Paris, les autres s’étaient soumis docilement au décret ;
quelques-uns n’en avaient pas tenu compte. Pontécoulant était de ceux là.
A la séance du 6 juin, il demanda que la Convention prit connaissance des lettres par lesquelles les détenus réclamaient que justice leur fût faite et que la Convention se prononçât sur leur culpabilité. « La commune de Paris ne peut fournir aucune preuve de ses imputations ; ce n’est pas une raison, dit-il, pour que nous refusions de prononcer sur le sort de nos collègues ; je veux croire que dans cette discussion on n’étouffera point la voix de ceux qui veulent justifier les dénoncés et accuser les dénonciateurs ».
Il était encore en liberté, lorsque Charlotte Corday fut traduite au tribunal révolutionnaire ;
elle demanda d’abord Pontécoulant pour défenseur ;
elle ne le connaissait pas ;
elle ne savait pas même quelle était son opinion politique ;
mais il était son compatriote, de la même province, où il avait une honorable réputation.
Comme il ne voulait pas courir la chance d’être arrêté, il avait quitté son domicile et changeait sans cesse de logement.
La lettre que lui écrivit Charlotte Corday ne lui fut pas remise.
« On n’a point trouvé son adresse », dit à l’audience l’accusateur public, qui s’était chargé de la faire parvenir.
Charlotte Corday supposa injurieusement qu’il avait refusé de se charger de sa défense.

Cependant l’insurrection du Calvados avait été facilement dissipée ;
Bordeaux s’était soumis sans résistance et Marseille peu après ;
Lyon allait succomber.
Les dominateurs de la Convention pouvaient en sécurité se livrer à leurs haines et à leur cruauté.
La reine était traduite devant le tribunal révolutionnaire.
Le 3 octobre 1793, après avoir entendu un rapport de son comité de sûreté générale, la Convention rendit un décret, qui c accusait quarante de ses membres de conspiration contre l’unité et l’indivisibilité de la République, contre la liberté et la sûreté du peuple français.
Aucune discussion ne s’éleva dans l’Assemblée, L’acte d’accusation présenté par Amar, inspiré par une haine féroce, partait sur des allégations vagues et mensongères que pas un des conventionnels présents n’eut le courage de contester. On imputait à Pontécoulant de s’être rendu à Caen avec Barbaroux et Buzot, tandis que notoirement il n’avait pas quitté Paris.

Il savait quel sort l’attendait au tribunal révolutionnaire, et se tint caché ; il fut mis hors la loi, et quelque temps après, il parvint à se réfugier en Suisse, déguisé en roulier.
Il n’avait nul moyen d’existence et entra comme apprenti chez un menuisier à Zurich. Pendant son séjour en Suisse, il rencontra le duc d’Orléans qui, lui aussi, avait été réduit à prendre une profession pour vivre et pour se cacher.
Le professeur de mathématiques et le menuisier se furent l’un à l’autre compagnons intimes d’infortune.
Longtemps après, le roi Louis-Philippe se plaisait à rappeler ce souvenir à Pontécoulant.

Le 17 décembre 1794, cinq mois après le 9 thermidor, les comités de salut public, de sûreté générale et de législation, cédant à l’opinion publique, qui pressait la Convention et la contraignait à réagir de jour en jour davantage contre les actes d’iniquité et de tyrannie du régime de la Terreur, proposèrent que les députés mis hors la loi fussent rendus à leurs droits de citoyen, mais non pas rétablis comme représentants du peuple.
Ce n’était pas donner suffisante satisfaction au sentiment et à la voix publics ; mais la majorité de la Convention ne se résignait pas encore à obéir à l’opinion du pays.
Après une séance orageuse à laquelle assistait Pontécoulant, au grand scandale des Montagnards, l’Assemblée adopta le décret. Il fallut encore quatre mois pour que la Convention en vînt à désavouer pleinement le 31 mai et la condamnation des Girondins.
Le décret, qui rappela les proscrits dans l’Assemblée, fut cette fois accueilli avec une faveur passionnée et adopté aux cris de « Vive l’Assemblée ! vive la République ! »
Un seul représentant se leva pour témoigner son refus : c’était Goujon, celui qui bientôt après devait périr comme un des promoteurs de l’insurrection du 1er prairial.

Pontécoulant ne se livra point à la réaction ;
par caractère et par expérience, il était contraire aux opinions exagérées et encore plus aux persécutions qu’elles suscitent ; il voulait la justice et la liberté :
il ne désespérait pas de la République et croyait encore qu’un gouvernement fort était nécessaire pour défendre la France contre la coalition et pour maintenir l’ordre intérieur.
Le discours qu’il prononça, le 26 avril 1795, pour appuyer la restitution des biens des condamnés est le plus remarquable de ceux qui furent entendus dans cette grande discussion. Il traita la question, non seulement sous le rapport des circonstances, mais dans toute sa généralité.
Pour les hommes qui ne voyaient pas sans chagrin et sans effroi qu’on revint sur un acte révolutionnaire quelconque, restituer les biens aux condamnés, c’était prononcer que leur sentence était une iniquité, qu’ils avaient été non pas jugés mais assassinés.
Ainsi ils résistèrent longtemps et vivement.
Pontécoulant allait plus loin, il voulait que la confiscation fût à jamais abolie en principe, et n’eût point place dans la liste des peines légales.
Ses adversaires prétendaient que ce serait compromettre la sûreté de la République et laisser à ses ennemis des moyens de vengeance et de conspiration.
Malgré le très grand succès du discours de Pontécoulant, il ne put obtenir l’abolition complète de la confiscation ; il a toujours tenu à honneur de l’avoir proposée.
La Convention déclara qu’elle serait maintenue à l’égard des émigrés, des conspirateurs, de leurs complices, et de la famille des Bourbons. Il était réservé à la Charte de leur restauration d’en prononcer la suppression définitive et absolue.

Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant Pendant qu’il combattait les principes et les œuvres des hommes de la Terreur, il s’opposait à la réaction qui les poursuivait, et pensait qu’en n’admettant pas l’excuse des circonstances, on perpétuerait les haines politiques et les discordes de parti.D’ailleurs on courait le risque d’imiter ceux qu’on voulait punir et de considérer les opinions et les discours comme des crimes punissables.Ce fut dans cette pensée qu’il prit la défense de Prieur de la Marne et de Robert Lindet. Son importance avait grandi dans l’Assemblée ; le 4 mai 1795, il fut nommé membre du comité de salut public.Dans ce gouvernement collectif, son tour étant venu de tenir la correspondance du département de la guerre, il ne se crut ni assez instruit, ni assez expérimenté pour diriger les opérations militaires et les mouvements des armées ;il ne voulait cependant pas se borner à signer des dépêches que lui présenterait le bureau de la guerre, qui pourtant avait été composé par Carnot d’hommes très distingués.A ce moment un jeune général, complètement inconnu ailleurs qu’a l’armée d’Italie, car il avait, n’étant que chef de bataillon, dirigé le siège de Toulon et donné ensuite à tous ceux qui avaient fait la guerre avec lui une haute idée de sa capacité, était à Paris, réclamant pour que son grade ne lui fût pas ôté.
Il avait trouvé peu d’accès auprès du comité militaire de la Convention. Repoussé et méconnu, sans argent et sans protection, il assiégeait les membres des comités de gouvernement et les hommes importants qui pouvaient lui être utiles ;
il exposait ses plans pour les armées, et spécialement pour l’armée d’Italie, s’animait en expliquant ses idées et les produisait avec un ton d’autorité et de certitude.
La plupart de ceux qui l’écoutaient, voyant ce jeune homme de peu de mine et d’une tournure étrange qui pensait en savoir plus que tous les généraux, et qui rêvait des victoires et des conquêtes, étaient fort tentés de lui croire l’esprit un peu troublé et de le prendre pour un de ces faiseurs de projets qui les racontent à tout venant.
C’était Napoléon Bonaparte.
Pontécoulant en jugea autrement ; sans deviner un si grand génie, il lui parut que cet officier disgracié disait des choses très raisonnables, qu’il montrait un esprit remarquable, et qu’il pouvait bien être un habile général.
Il se promit de ne rien décider et de ne rien écrire sans avoir pris les avis du jeune officier d’artillerie. Napoléon fut touché de cette confiance, dont il a toujours été reconnaissant.
Ce fut par suite de ses rapports avec Pontécoulant qu’il fut attaché au bureau militaire du comité de salut public, où Barras, qui l’avait connu au siège de Toulon, le retrouva pour lui confier la défense de la
Convention et le combat du 13 vendémiaire contre les sections de Paris.
Du 4 mai au 4 septembre, Pontécoulant, occupé des affaires militaires, ne prit point part aux discussions de l’assemblée :
il la présida pendant la première quinzaine du mois de juillet.
Le 3 septembre il proposa, au nom des comités de gouvernement, l’abrogation du décret, rendu trois ans auparavant, qui avait destitué le général Montesquiou au moment où il venait d’envahir toute la Savoie. Montesquiou s’était dérobé à l’échafaud et réfugié en Suisse.
Le rapport de Pontécoulant le justifiait pleinement et faisait valoir ses talents et ses services ;
il fut rappelé en France et rayé de la liste des émigrés.
Après le 13 vendémiaire, Pontécoulant était placé dans les rangs opposés aux représentants, qui voulaient profiter de cette victoire pour ajourner la constitution, pour continuer le gouvernement absolu de la Convention et lui rendre sen caractère de tyrannie révolutionnaire.

Dans ce moment les agents royalistes, à qui le mouvement de l’opinion publique contre tout ce qui avait pris part au règne de la Terreur, faisait illusion, se croyaient assurés d’avance de la coopération des députés opposés au parti terroriste.
Leurs correspondances témoignaient de cette frivole espérance.
Dans les papiers d’un nommé Le maire, qui fut arrêté, puis condamné à mort, le nom de Doulcet (c’était le nom que portait alors Pontécoulant), se trouva compris dans une liste de représentants, sur lesquels l’agent disait que les royalistes pouvaient compter.
Ce renseignement était encore plus absurde, quant à Pontécoulant, que quant à ses collègues. Il y avait eu confusion de noms ; c’était d’un avocat nommé Doucet que l’agent royaliste avait voulu parler.
Pontécoulant n’avait pas même pensé à se justifier.
Tallien, Letourneur et d’autres conventionnels du parti révolutionnaire s’empressèrent de parler de l’activité et des soins qu’il avait manifestés pendant que les affaires militaires avaient été ms sa direction.
Les élections témoignèrent quelle honorable popularité Pontécoulant s’était acquise par sa conduite, par ses discours, par son dévouement à la justice, à la modération et aux vrais intérêts de la nation.
Un décret de la Convention avait ordonné que les deux tiers du nouveau corps législatif seraient choisis par les collèges électoraux parmi les membres de la Convention.
Pontécoulant fut élu par trente-trois départements. Il siégea au conseil des Cinq-Cents.
Pendant les vingt mois, qui s’écoulèrent entre l’établissement de la constitution de l’an III et le 18 fructidor, il prit une part active aux travaux de cette Assemblée, toujours étranger à l’esprit de parti qui lui était antipathique ;
toujours ami de l’ordre et de la justice ; toujours disposé à contrôler avec indépendance les actes du pouvoir, sans chercher à l’affaiblir.
C’en était assez pour être classé parmi les ennemis du Directoire.
Prévoyant l’attentat projeté contre le corps législatif, il parla et vota pour les mesures impuissantes qui furent proposées dans l’espoir de s’en garantir.
Aussi fut-il placé sur la liste des députés destinés à la déportation, qui fut présentée au conseil des Cinq-Cents.
Il était si notoirement éloigné de tout sentiment hostile, de toute opposition systématique au gouvernement, que des réclamations s’élevèrent et que son nom fut effacé.
Il protesta contre ce coup d’État, contre cette ruine de la constitution et renonça à siéger désormais dans une assemblée, qui avait été militairement envahie et décimée en violation des lois et de la justice. Retiré dans sa province, il se fit élire assesseur du juge de paix de son canton, pensant que ce pourrait être une sauvegarde contre la persécution des agents du Directoire.

Il n’était pas à Paris lorsque le général Bonaparte, à la grande et universelle satisfaction de la France, détruisit le gouvernement directorial et devint, par une constitution nouvelle, maître absolu du pouvoir.
Il n’avait pas oublié son ancien protecteur, celui qui, par un heureux hasard, avait facilité son premier pas sur la route par où il devait arriver au faite de la gloire et de la puissance.
Pontécoulant n’avait point d’ambition ; il souhaitait une position convenable à son rang social et à ses antécédents politiques ; son goût ne le portait pas aux affaires, et il n’aimait pas la responsabilité.
Le Premier Consul l’aurait volontiers placé au Sénat, mais il était âgé de trente-six ans et les sénateurs devaient avoir quarante ans ; il fut nommé à l’importante préfecture de Bruxelles.
Il fit jouir d’une administration juste, douce et intelligente un pays qui jusqu’alors avait été traité en pays conquis, après avoir éprouvé toutes les calamités du théâtre de la guerre.
Il fit cesser les persécutions, rappela les émigrés, leva le séquestre établi sur leurs biens, appela aux fonctions publiques les grands propriétaires, fit revenir les prêtres déportés, rétablit les fondations pieuses et charitables.
Telle fut, à cette époque, la mission des préfets ; mais ces bienfaits étaient encore mieux sentis dans une province qui avait tant souffert des désordres de la Révolution et de la guerre.
En 1805, dès que Pontécoulant eut atteint l’âge légal, il fut nommé sénateur. L’année suivante, le goût des voyages, qu’il avait conservé, lui fit désirer de se rendre, sans fonction ni titre, à Constantinople avec le général Sébastiani, qui venait d’être choisi pour cette importante ambassade. L’Empereur l’encouragea dans ce projet.
Il assista et s’employa activement à la glorieuse défense de Constantinople contre l’escadre anglaise, qui avait passé les Dardanelles.
Le Grand Seigneur lui donna l’ordre du Croissant.
L’Empereur le chargea ensuite d’une mission auprès du grand vizir, qui commandait l’armée turque sur le Danube, et il passa plusieurs mois à son état-major.
Il revint en France à la fin de 1807. Deux fois il fut envoyé par mission extraordinaire en Normandie : pour aviser aux précautions qui devaient défendre la côte contre les attaques des Anglais ;
puis, en 1813, pour presser la formation des cohortes de garde nationale.
Un plus difficile et plus triste devoir lui fut imposé à la fin de 1813 :
l’Empereur l’envoya en Belgique au moment où elle allait être envahie par les armées alliées.
Le général Maison arrêta pendant quelque temps cette invasion avec une petite armée, et le commissaire extraordinaire, secondé par des préfets qui, comme lui, avaient su gagner la confiance et l’affection des habitants, parvint à maintenir l’ordre et la fidélité dans ces provinces, jusqu’au moment où les armées étrangères les occupèrent entièrement.
Il revint au Sénat ; peu après, Paris tomba au pouvoir des alliés.
Le 1er avril 1814, le Sénat fut convoqué, vota la formation d’un gouvernement provisoire, et déclara en même temps quels devaient être les principes et les dispositions générales d’une nouvelle constitution.
M. de Ponté-coulant se trouva à cette séance et la déclaration du Sénat porte sa signature ;
elle ne se trouve point à l’acte du Sénat daté du 3 avril, qui prononce la déchéance de l’empereur Napoléon.
Le 4 juin 1814, le jour où la Charte fut promulguée, la Chambre des pairs fut formée ;
tous les sénateurs, hormis ceux qui n’étaient pas Français, et les conventionnels qui avaient voté la mort de Louis XVI, furent appelés par le roi à en faire partie.
A son retour de l’île d’Elbe, Napoléon changea les constitutions de l’Empire ;
cédant à l’opinion publique encore émue des calamités que le pouvoir absolu avait appelées sur la France, il institua, par un acte additionnel, un gouvernement représentatif ;
une Chambre des pairs héréditaire était un des grands pouvoirs de l’État ; Pontécoulant en fit partie.

Elle ne s’assembla que pour assister à la seconde ruine de la fortune et de la puissance de Napoléon.
Dans cette triste session, au milieu de circonstances menaçantes, Pontécoulant eut plusieurs fois à prendre la parole.
Il soutint qu’en un tel moment, lorsque les chambres étaient le seul pouvoir encore subsistant, le salut du pays tenait à leur permanence :
« Quiconque tenterait de les dissoudre, disait-il, doit être déclaré traître à la patrie, et je me porte, dès à présent, son dénonciateur ».
Dans la séance du 22 juin, il prit vivement la défense de son beau-frère, le général Grouchy, dont le maréchal Ney avait blâmé la conduite.
Dans cette même séance du 22 juin, lorsque le prince Lucien Bonaparte insista pour que le fils de l’Empereur fût explicitement reconnu comme son successeur, Pontécoulant parla en ces termes :
« Je vais dire ce que je ne dirais pas si Napoléon était encore au faite de la puissance :
je lui suis entièrement dévoué du plus profond de mon cœur ;
je l’ai servi fidèlement ;
je lui serai fidèle jusqu’au dernier soupir ;
je lui dois tout ;
il a été pour moi le bienfaiteur le plus généreux.
Mais aussi je me dois à la patrie.
Que nous propose-t-on ?
Une chose contraire aux usages de toutes les assemblées délibérantes : de prendre la plus grave détermination sans délibérer.
« Et quel est celui qui vient nous parler de minorité factieuse et qui veut imposer un souverain aux Français ?
Je reconnais les droits qu’il s’est acquis à l’estime générale par ses talents, son beau caractère, et par ce qu’il a fait pour la liberté. Mais ses titres, pour parler ainsi qu’il vient de le faire, ne me sont pas connus.
Aucun acte n’atteste qu’il soit Français ; nous ne le connaissons que comme prince romain.
Le prince Lucien nous propose une chose que vous ne pouvez accorder, sans une mûre délibération.
L’Empereur demande, par sa proclamation, que son fils soit reconnu comme son successeur.
Quelle que soit ma reconnaissance pour Napoléon, je ne puis regarder comme mon souverain un individu, qui n’est pas en France ; je ne puis regarder comme régente une princesse qui est en Autriche ; sont-ils étrangers ? Sont-ils captifs ? Veut-on vous amener à reconnaître une régence ? Si l’on prend ce parti, on allume les flambeaux de la guerre civile »
.

Quelle que fut l’insistance passionnée d’un grand nombre de pairs, il leur fallut se contenter d’affirmer, sans être contredits, que le droit de Napoléon Il était implicitement reconnu.
Mais un gouvernement provisoire, qui n’était point un conseil de régence, et dont les actes ne devaient point porter le nom de Napoléon II, fut élu par les deux chambres.
Ce gouvernement, qui était composé du duc d’Otrante, de Carnot, du duc de Vicence, du général Grenier et de Quinette, résolut d’envoyer des commissaires au quartier général des alliés, afin d’y tenter une négociation.
Ces commissaires furent La Fayette, d’Argenson, le général Sébastiani, Pontécoulant et La Forest. Lorsque Pontécoulant annonça la commission qui venait de lui être donnée et demanda le congé de la Chambre des pairs, d’Arjuzon se rendit l’organe des sentiments de la Chambre :
« C’est avec regret que nous voyons de Pontécoulant s’absenter de la Chambre où ses lumières sont d’une si grande utilité. La connaissance que nous avons de ses principes et de sa sagesse, nous donne l’espérance que cette mission aura un résultat heureux ».
C’était se faire une étrange illusion. Les commissaires se rendirent à Haguenau ; ils ne furent pas admis auprès des souverains. S’il y avait eu possibilité de négocier, c’eut été avec les généraux étrangers, qui assiégeaient Paris.
Il n’y eut à Haguenau que des conversations non officielles, dont on savait de part et d’autre l’inutilité. Louis XVIII rentra à Paris le 8 juillet ;
par une ordonnance du 24, il statua que les pairs qui avaient accepté la pairie créée pendant les Cent Jours étaient regardés comme démissionnaires. Pontécoulant et vingt-sept autres pairs se trouvèrent ainsi ne plus faire partie de la Chambre.
Lorsque les impressions des Cent Jours furent affaiblies, lorsque le roi eut appelé un ministère, qui se proposait de rallier au gouvernement les hommes notables par les positions importantes ou les fonctions que le pouvoir impérial leur avait conférées, les pairs que l’ordonnance de 1815 avait écartés furent réintégrés par une nomination nouvelle.
La rentrée de Pontécoulant à la Chambre des pairs fut particulièrement remarquée, et l’on assura que le roi y avait consenti avec quelque difficulté.

Il y fut accueilli avec une bienveillante satisfaction. Rien n’était changé dans son caractère, ni dans ses opinions. Le passé ne lui avait laissé nulle rancune, nul préjugé contre les personnes ; comme toujours il répugnait à tout esprit de parti ; il n’avait ni ambition, ni désir de succès.
« Il était, disait-il lui-même, parfois mécontent, jamais opposant ».
Assidu aux séances, il prenait rarement la parole dans les discussions et ne faisait jamais de longs discours.
Lorsqu’il s’était préoccupé d’une question particulière, lorsque quelques paroles dites à la tribune avaient fait impression sur lui, il exprimait son opinion d’une façon nette et claire, avec une sorte de vivacité, qui avait parfois une apparence d’irritation : habitude qu’avaient contractée la plupart des anciens conventionnels dans leurs luttes passionnées, lorsque, dans l’attaque et la défense, il s’agissait d’imposer au pays une horrible tyrannie ou de l’en préserver, lorsque les combattants se menaçaient mutuellement de l’échafaud.
Il était écouté avec intérêt et même avec faveur ; on respectait en lui l’autorité de l’expérience ; on déférait volontiers aux avis de ce vétéran des assemblées délibérantes, de ce témoin des variations révolutionnaires.
C’était surtout lorsqu’il se présentait quelque question relative aux prérogatives de la Chambre, au mode de délibération, à la marche de la discussion qu’il était volontiers consulté ; aussi était-il toujours placé dans les commissions chargées de réformer quelque article du règlement, ou
de déterminer la marche à suivre dans les procédures portées devant la Cour des pairs.
L’avènement du roi Louis-Philippe, qu’il avait prévu sans le désirer, lui parut, ainsi qu’à tous les hommes sensés, le seul moyen de préserver la France du désordre où pouvait la jeter une révolution accomplie par le mouvement populaire, que le gouvernement du roi Charles X avait imprudemment provoqué, en violant les lois.
Pontécoulant ne désirait aucun changement dans sa position : son attitude, ses opinions, son langage, restèrent tels qu’auparavant ; la faveur personnelle dont il pouvait jouir auprès du nouveau souverain ne lui donna point la moindre velléité d’ambition.
Lorsque, deux mois après cette révolution, le roi eut à former un nouveau cabinet, il pressa Pontécoulant d’accepter le ministère de l’intérieur, mais ne réussit pas à l’y décider. Pendant les dix-huit années de ce règne d’ordre et de liberté, il continua à siéger assidûment à la Chambre, où la sagesse de ses opinions et la tranquillité de sa conduite augmentaient de plus en plus la considération dont il jouissait parmi ses collègues et dans la région du gouvernement.
Il se tint éloigné de toutes les dissensions, qui divisèrent et affaiblirent le parti conservateur ; déplorant les rivalités, les luttes et les inimitiés des hommes distingués par leur talent et leur caractère qui se succédèrent et se remplacèrent dans le ministère. Les uns comme les autres témoignèrent constamment des égards et de la déférence à Pontécoulant.
En avril 1840, il reçut le grand cordon de la Légion d’honneur.
Il avait atteint l’âge de quatre-vingt-trois ans, lorsque éclata la révolution de février 1848. Elle attrista ses dernières années ; il vit renverser à la fois le trône, les deux chambres, toutes les institutions et toutes les garanties de la monarchie constitutionnelle.
Le gouvernement, en qui il avait mis le plus d’espérance, qui avait eu le plus ses sympathies, succomba, et la France fut rejetée aux hasards des révolutions.
Il se retira dans la vie privée qu’il avait toujours préférée à toute autre. Ses convictions lui étaient une cause de regret et de chagrin, mais elles ne s’affaiblissaient point. Il n’espérait plus voir son pays jouir de la liberté dans les limites de la loi, et gouverné par un pouvoir, plutôt aidé que contrarié par les conseils et le contrôle d’une élite d’hommes éclairés et indépendants ; mais il croyait toujours qu’un gouvernement ne serait stable et respectable qu’à ces conditions.
Lorsqu’on lui disait en quelle défaveur était tombée l’opinion à laquelle il avait été constamment fidèle, il répondait en souriant : Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.
Il conservait, dans cette extrême vieillesse, une santé inaltérable, une vitalité énergique, lorsqu’une fracture accidentelle le condamna
à ne plus quitter son fauteuil ou son lit.
Il soutint avec courage et sérénité cette souffrance et cet ennui. Entouré d’une famille, dont les soins et la tendresse lui étaient doux, d’anciens amis, dont le commerce était pour lui une agréable distraction ;
conservant tous les souvenirs d’une vie commencée parmi une aristocratie élégante et frivole, puis passée tout entière dans les tempêtes, les misères, les continuelles diversités des révolutions,
il se plaisait à être interrogé par la curiosité d’une génération ignorante du passé ; en même temps il lui inspirait un esprit de tolérance, d’indulgente appréciation, de résignation sans apostasie, de soumission sans servilité.
Plus d’une année s’écoula ainsi. Le vieillard « attendait la mort sans la désirer, ni la craindre ».
Le 3 avril 1853, au milieu d’une lecture qu’il écoutait, conservant sa physionomie habituelle de calme et de bonté, il s’éteignit sans douleur. Il avait quatre-vingt-huit ans et cinq mois.
Source : http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article885
 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
..Dona Rodrigue...